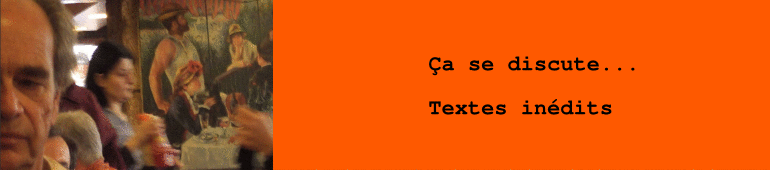Figure ci-dessous, une version revue et surtout enrichie de ses références sonores, de "L'oreille jazz : essai d'ethnomusicologie", que j'ai publié dans Circuit, Vol. 14, N°1 (2003)
Retour à la notion d'oreille culturelle
[suite de "l'Oreille de l'ethnomusicologue" abordée dans le blog, chapitre "Orientations"] :
Tout musicologue est – ou devrait être – confronté aux deux caractéristiques fondamentales de l’oreille humaine : naturelle et culturelle. L’ethnomusicologue, quant à lui est est bien placé pour en souligner et approfondir les propriétés culturelles. S’il veut rendre compte efficacelement des faits qu’il observe, il doit construire et constamment réorganiser son écoute au contact étroit avec la matière musicale qu’il observe sur un mode participatif. Sa qualification le dote en principe d’une oreille à la fois caméléon et ascétique, qui s’adapte aux réalités sonores qu’on lui donne à entendre et dont elle se nourrit 1. Curieusement, alors même que, depuis de longues années, cette oreille est au centre des débats 2 de notre discipline et qu’aucune thèse d’ethnomusicologie digne de ce nom n’en ignore l’existence, elle n’a pas, en tant que telle, donné lieu à des publications décisives.
Pour sa part, l’ethnomusicologue est étrangement discret sur ce problème pourtant central. Il se contente le plus souvent de faire entendre sur disque ou de transcrire du mieux qu’il peut la production musicale des gens chez qui il travaille, en soulignant, bien entendu son contexte spécifique, mais sans dire grand chose sur ce que cette pratique implique sur le plan des aptitudes cognitives. Tous les ethnomusicologues semblent s’être mis d’accord pour laisser de côté les aspects théoriques de la question et se pour rappeler à loisir – peut-être même abusivement – que “chez eux”, c’est-à-dire sur “leur” terrain, ce n’est pas comme ailleurs : la production esthétique et, plus exactement, l’art de produire du sens avec des sons, y est particulière. “Là-bas, disent-ils en substance [chez les Pygmées, les Zoulous, mais aussi les Sardes ou les Roumains du Pays de l’Oach], les codes divergent des nôtres, autant que les aptitudes qui servent à les déchiffrer”.
En pratique, on peut relever chez eux trois positions :
La première – impériale (pour ne pas dire impérialiste) – consiste à s’attribuer l’aptitude des autres sans trop se poser de questions : à reconnaître certes l’existence de savoirs musicaux particuliers mais sans stipuler que leur mise en œuvre implique une “mentalité culturelle”, pourrait-on dire, tout aussi particulière. L’(ethno)musicologue serait un super-musicien dont les connaissances techniques engloberaient celles de tous les autres. Dans cette optique, science universelle et construction personnelle du chercheur s’applatissent pour constituer un seul et même discours.
À l’opposé, la deuxième position est franchement négative et plutôt décourageante. C’est celle du maître de musique persane disant à son élève, Bruno Nettl – pourtant grand professeur d’ethnomusicologie à Illinois-USA – : “You will never understand this music” : "Vous ne comprendrez jamais [notre] musique” . Sous-entendu : ne perdez pas votre temps à l’apprendre! " [anecdote citée par Bruno Nettl lui-même dans son livre, 1983, p. 259].
La troisième adopte la voie du milieu – celle que je défends. Cette position prend acte du constat courageusement relaté par Nettl [courageux car le propos du maître de musique en cache un autre, qui peut se résumer en ces termes : “comment, Monsieur Nettl, pouvez-vous écrire des livres sur quelque chose que vous êtes incapable de comprendre?”]. Mais elle soutient qu’à moins d’être totalement sourd ou handicapé, la musique des autres est accessible, et que cette accessibilité problématique constitue justement le cœur de la recherche ethnomusicale [cf. publication Bouët/Lortat-Jacob/Radulescu, 2002].
Concernant le Jazz :
On attendrait d’un ethnomusicologue écrivant sur le jazz qu’il apporte des réponses documentées sur une de ses propriétés majeures : à savoir son caractère hybride, né de l’esclavage et de contacts historiquement circonscrits entre populations noire et blanche. Or, il ne sera pas du tout question de cela, mais seulement de musique et d’oreille musicale.
Ce que, néanmoins, il y a d’ethnomusicologique dans la démarche présentée ici, c’est sa distance analytique : celle d’un ethnomusicologue prenant méthodologiquement ses marques par rapport à une musique exogène ou ethnique. Je précise en effet que mon grand intérêt pour le jazz ne fait nullement en moi un “jazzman” convenable. Pas plus que la musique pygmée ne le fait pour un ethnomusicologue africaniste. Le jazz n’est en rien ma langue musicale : vis à vis de lui, je fais preuve d’une attention à la fois amoureuse et distanciée, propre en somme à satisfaire les exigences ordinaires de l’ethnologie.
1. Chet Baker chante faux ?
La présente étude a pour origine une anecdote dont Chet Baker est le personnage central. Je suis en effet frappé depuis de longues années par les réactions que suscite sa musique. Réactions contrastées et jugements franchement contradictoires, selon que ceux qui les expriment sont des musicologues formés à l’art classique ou des jazzmen expérimentés.
Rendons-nous directement à ce qui pourrait sembler être une conclusion, mais qui, en fait est une hypothèse : pour les premiers, Chet Baker – ce très grand trompettiste et intrigant chanteur – chante faux; pour les seconds il chante juste. “Horriblement faux” disent même parfois les musicologues classiques ; “délicieusement juste”, rectifient les jazzmen. Et sur cette question, je n’ai jamais rencontré de jugement hésitant ou mitigé.
Du fait des propriétés sémiotiques qu'on lui prête – art de "distinction" par excellence – la musique a l'étonnante capacité de produire du jugement et de générer de la micro-culture à un très haut niveau de finesse. Aussi ne faut-il pas s'étonner que dans un même immeuble parisien résident un jazzman, grand amateur de Chet Baker (et de sa justesse, donc) et, peut-être à l'étage en-dessous, un violoniste de l’opéra de Paris n’appréciant pas ce chanteur-trompettiste justement parce que ses intonations sont singulièrement approximatives.
Chet Baker est donc le sujet d'une diatribe entre les amoureux de musique que nous sommes
.Mais il s'agit d'une diatribe particulière qui ne traduit pas seulement des appréciations esthétiques contrastées (après tout, 'chacun ses goûts !);
elle se fonde – ou prétend se fonder – sur des données relevant de l'acoustique, à ce titre mesurables et objectivables.
Tentons de caractériser “l’ordre de justesse” de Chet Baker, à partir d’un exemple :
fig. 1 . Chet Baker : “I fall in love so easily” . Référ. Chet Baker Sings, 1956, Pacific Jazz Records, 23234, plage 13 [transcription B.L.-J].
Cette chanson [song], est loin d’être un chef-d’œuvre. Elle est plutôt plate et son texte relativement commun. L’ensemble est beau pourtant, pleinement conforme au style de Chet, et assez facile à analyser. En outre, le chanteur donne toujours l’impression de conformer sa voix aux nécessités de l’analyse. Le caractère lisse de l’émission “croonée”, une utilisation systématique de sons filés et une absence de vibrato permettent en effet d’obtenir des analyses précises. Nul doute qu’avec des chanteurs plus expressifs – en fait tous le sont plus que lui – exploitant de longs transitoires et ayant recours à des enveloppes de son plus hétérogènes, les résultats auraient été moins convaincants.
Pour mesurer les écarts de hauteur par rapport au système tempéré, on s’est servi du logiciel AudioSculpt – son degré de précision semble excellent – en se calant sur l’harmonique 2, sensiblement plus saillant que le 1 (comme souvent dans le chant). L’examen du spectre, très clair jusqu’à l’harmonique 8 permet de confirmer les données de l’analyse.
2. Chet Baker chante juste :
Les résultats, qui ont été portés sur la figure 2, peuvent être résumés, non sans avoir noté au préalable des écarts considérables par rapport au tempérament (+ 50 cents, soit 1/4 de ton, et - 30 cents). On observe :
1) certains degrés sont d’une grande stabilité et justesse : notamment les finales en valeur longue et ce quelle que soit leur fonction tonale;
2) En terme d’intervalles, les tierces majeures sont systématiquement réduites (jusqu’à - 50 cents, de sorte qu’elles ne sont plus majeures ni mineures);
3) les tierces mineures systématiquement élargies (jusqu’à + 30 cents);
Ces deux phénomènes s’analysent bien en terme de “blue notes”, système dans lequel l’opposition majeure/mineure est régulièrement gommée (en témoigne très clairement le fa # très bas sur l’accord de ré de la dernière portée).
Mais on notera également :
4) un renoncement systématique au chromatisme tempéré. Tous les 1/2 tons sont systématiquement élargis.
5) Enfin, le rôle de la pente mélodique : tendance à descendre les degrés pour les pentes mélodiques descendantes et à les monter pour les pentes ascendantes. Mais il s’agit là d’un phénomène qui ne semble pas propre à Chet Baker, ni même aux jazzmen.
Ces données pourraient être affinées. Retenons cependant qu’elles sont largement confirmées par l’analyse d’autres tunes du même musicien.
On s’est ensuite laissé tenté par une expérience qui consista à demander à un chanteur de formation classique de déchiffrer la notation de la figure 1 en lui donnant comme consigne, tout simplement, de chanter juste, mais sans toutefois lui interdire d’imprimer à la chanson le caractère expressif qu’il souhaite. Précisons que l’expérience sollicitant le savoir-faire d’un chanteur expérimenté mais non professionnel, s’est faite sans référence à la version originale, et sans que ne figure sur la partition l’harmonie d’origine. On a cependant orienté l’attention de l’interprète en suggérant des schémas de tonalité les plus classiques, en privilégiant les accords à trois sons (sauf pour les dominantes). Pour des raisons techniques, notamment le vibrato vocal, assez systématique dans l'art classique occidental, qui aurait rendu la lecture sonagraphique difficile, il a été demandé au chanteur de siffler la chanson, ce qui permet de relever les hauteurs des fondamentales avec plus de précision.Le résultat obtenu est reporté sur la figure 3.
Fig. 3. Le même 'tune' [version sifflée], par un chanteur de formation classique.
Les déviations par rapport au témpérament sont écrites au-dessus des portées. La chanson, simple dans dans sa forme est clairement sous-tendue par une pensée tonale. Les cercles signalent les sensibles, toujours hautes, les rectangles souligne les ajouts de brillance impliquant un léger rehaussement des degrés; les lignes indiquent les pentes mélodiques introduisant, elles aussi, une altération des hauteurs.
On s’en rend compte : par rapport au système tempéré, les déviations imposées par une exécution classique de “I fall in love” (de + 20 cents à – 10 cents), sont moins importantes que dans l’exécution “jazzy” de Chet Baker; mais elles n’en sont pas moins présentes. Elles semblent d’abord répondre à un souci de renforcement de l’harmonie tonale – un souci dont ne faisait apparemment pas montre l’exécution de Chet Baker. Cette pensée tonale invite tout naturellement à “monter les sensibles” (encerclées dans la figure 3). Par ailleurs, les quintes de l’accord sous-jacent sont systématiquement un peu hautes – sans doute pour répondre à un souci de brillance (elles figurent dans des rectangles aux bords arrondis); les mouvements ascendants et descendants semblent également jouer un rôle dans la distorsion du tempérament.
Ces deux analyses – ici très condensées – ont pour principal mérite de compléter efficacement notre question initiale. À l’évidence Chet Baker ne chante pas juste, sauf lorsqu’il s’efforce, avec une précision très remarquable de prolonger les finales, point d’arrivée de ses mélodies. Il s’évertue, semble-t-il systématiquement, à “casser” les deux propriétés du système tonal et la distinction très franche instaurée entre chromatisme et diatonisme. Choix qui s'oppose drastiquement à celui de l'art classique.
Bref, il y a dans la façon de faire de Chet Baker autant la négation du tempérament classique que l'affirmation d’un autre tempérament tendant à :
1) réduire l’opposition majeure/mineure fondatrice du système tonal;
2) ignorer le chromatisme stricto sens (intervalles à 100 cents) pilier du système tempéré.
Notre interprète classique quant à lui, s’oriente vers d’autres conventions : soucieux de marquer sa compréhension de l’harmonie tonale sous-jacente, il n’hésite pas à surligner les sensibles 3 (en les altérant vers le haut) et donner une certaine emphase aux modulations (cf. son fa # introduisant le passage en ré majeur de la dernière portée). De sorte que, si l’on s’en tient à une définition strictement acoustique de la justesse, on ne peut pas dire qu’il chante juste, lui non plus.
3. Exploration du côté des structures sous-jacentes :
a) Parker et Miles
C’est ainsi que jazzmen et classiques sont, pour ce qui est de la justesse, renvoyés dos à dos. Il ne s’agit pas d’approfondir la diatribe, mais plutôt d’en comprendre les mécanismes, tout en prenant au pied de la lettre le caractère irréconciliable de leurs positions.
Nous ferons donc l’hypothèse qu’elle mettent en œuvre des aptitudes fondamentalement différentes. Nous nous intéresserons ici à celle des jazzmen produit d’une pratique de “leur” musique (instrumentale, vocale et, tout autant, acquise par l’écoute) – aptitude qu’il est relativement facile de mettre en évidence par une série d’expériences. C’est ainsi qu’à l’écoute d’un disque de Charlie Parker ou de Miles Davis des années quarante, un “bopper” qualifié n’aura pas de difficultés à mettre en relation une variation avec son thème sous-jacent et son harmonie d’origine – et ce quelle que soit la distance qui les sépare.
"Billie's Bounce" , version publiée Charlie Parker, Miles ed altri.
La première hypothèse fut la suivante : pour un jazzman entraîné, – mais non pour un musicien classique – le thème, dans sa structure typique de be-bop ne pose pas de problème d'identification et la structure harmonique notamment reste clairement identifiable malgré le riche jeu de variations qu'enclanche Parker dès son entrée en lice.
Par chance, nous disposons de cinq prises successives de cette pièce ['Savoy session' du 29 novembre 1945] dont je donne les extraits centrées sur entrées-chorus de Parker, toutes très différentes les unes des autres :
Sur cette base, une expérience a pu être réalisée visant à tester le degré de compréhension du système de variations de Parker : elle a consisté à faire entendre les débuts de ces chorus "nus", c’est-à-dire sans harmonie. Pour cela, il a suffi de les retranscrire et les faire jouer par l'ordinateur, sans accompagnement :
Fig. 4. Les cinq entrées en chorus de Parker, sans leur substrat harmoniquo-thématique.
Deux populations d’experts ont été sollicités : trois musiciens classiques (dont deux titulaires d’un prix de conservatoire) et quatre jazzmen, dont un professionnel. Il leur a été demandé de trouver l’harmonie commune aux cinq énoncés.
Rien de très probant n’a été obtenu auprès de la première population d’experts –ceux de formation classique . Disons qu'ils ont été déroutés par les mélodies de Parker. Les Jazzmen en revanche n'ont pas eu de difficulté à identifier très rapidement une grille de blues – fa M, sib 7, fa M, doM7.
Pourquoi cet exercice fut-il si difficile pour les experts en art classique ? notamment parce que, (notamment dans les formules encerclées de la figure 4) , il faut entendre un FA majeur, sous jacent; dans celles encadrées, un SI b Majeur7, ce qui – reconnaissons-le – n'est pas évident.
On peut alors tenter de recomposer l'écoute Jazz : le thème, en tant qu'il est porteur d'harmonies blues, parfaitement cycliques, et qui seront maintenues jusqu'à la fin de la pièce – y compris bien entendu lors des magnifiques entrées successives de Miles – semble ne rien perdre de sa prégnance dans la pensée créative de Parker. De sorte que l'on peut, très approximativement, recomposer son écoute, par voie synthétique, en faisant jouer à notre ordinateur à la fois les chorus de l'immense saxophoniste et à la fois le thème et l'harmonie qui guide son oreille avant de diriger ses doigts :
Version "synthétique" de Billie's bounce : exposition du thème puis superposition des cinq entrées de Parker transcrites ci-dessus.
En conclusion, on peut estimer que ce qui caractérise une population d'experts (en l'occurrence, les jazzmen), c'est sa capacité à coder sa propre écoute sur la base de la musique qu'elle a l'habitude et le goût d'entendre ou de pratiquer. C'est pourquoi, du fait de cette simple familiarité, "l'oreille-jazz" ne se sent déroutée ni par l'harmonie, ni par les carrures et mélodies brisées dont, par exemple, les boppers se sont fait une spécialité, ni par le swing qu'au contraire ils recherchent. Sans en être conscient, sans doute, ils ont échafaudé des codes qui leur permettent de mettre en correspondance les différents plans harmoniques, accentuels, intonationnels et timbriques. L'harmonie jazz ne se laisse appréhender que si on en connaît les codes (rôle essentiel de la septième majeure dans les systèmes d'accord, par exemple aboutissant à nier la consonnance simple des accords à trois sons, ou jeu de substitutions harmoniques subtiles permettant d'éviter les dominantes). Les accents sont, quant à eux à mettre en relation avec une conception du rythme et du swing, impliquant à la fois un marquage des temps et une certaine façon de se jouer de ce marquage. Le timbre ne peut être compris dans sa complexité qu'à travers des considérations sur la notion de "son" en jazz et, pour ce qui est des qualités d'intonation, on peut se référer à la partie dédiée à Chet Baker aux paragraphes précédents.
On retiendra de ces expériences que si l’expression “avoir de l’oreille” peut revêtir une certaine signification à l’intérieur d’un conservatoire supérieur de musique, elle la perd sitôt franchies les portes de ce même conservatoire : un musicien classique expert, quels que soient ses dons – disons Pierre Boulez, par commodité – est sans doute incapable de se repérer dans les finesses timbriques de la musique Techno, et probablement peu sensible à la qualité de “swing” des jazzmen 5 . À l’inverse, il ne sera pas étonnant de trouver chez ces derniers des surdités occasionnelles portant , par exemple, sur des grandes formes du répertoire romantique.
Une affaire entendue : ce qui est étonnant, c'est que cette “oreille-Jazz”, dont on a souligné ici que quelques aspects, n’a guère plus de soixante ans d'âge. En fait, elle dut se former avec l’objet qu’elle a créé et domestiqué. C’est une oreille culturelle, que chacun peut acquérir, et dont le fonctionnement suppose l’existence d’un double dispositif, conforme au moins en partie à celui que soulignent les ethnolinguistes (Hess, Foss, Simpson) qui, pour la production et la reconnaissance d’énoncés linguistiques supposent la présence de deux modèles : 1) un modèle d’activation des connaissances et 2) un modèle d’intégration des événements dans une structure globale. Or, si ces deux modèles sont communs à toute l’humanité pensante et entendante, ils touchent à des ordres de compétences culturellement très variables – sans parler du fait qu’on est loin d’avoir fait le tour de l’immense diversité des connaissances sollicitées dans les actes de cognition musicale sollicités par tous les hommes de notre planète. Ce qu’on sait, en revanche, c’est que les événements musicaux sont fondamentalement soumis à la façon dont on les pense et qu’ils ont d’abord et surtout une existence mentale. Et c’est bien pour cela que toute démarche strictement analytique concernant un objet musique totalement réifié, sans référence au sujet qui le pense, a peu de chances d’arriver à des résultats convaincants. La musique est donc non seulement une "affaire entendue", mais "sous-entendue” 6. Au nom d’une science positiviste serait absolument erroné de considérer que les stratégies d’écoute sont secondaires dans l’acte de cognition musicale. Celles-ci ont la capacité non seulement d’orienter l’attention de l’auditeur, mais aussi celle de l’organiser complètement au point même de créer les objets qu’on lui donne à entendre.
On ne manquera pas d'observer en conclusion, que grâce à l’ethnomusicologie, l’acoustique musicale n’est plus tout à fait une science exacte; elle est aussi une science humaine dans la mesure où, à partir de l’épais spectre offert par un son musical quelconque, tout homme sélectionne ce qu’il veut bien entendre – ou ce que sa culture lui a appris à entendre. De sorte qu’il n’est pas présomptueux de penser qu’une musicologie générale impliquant nécessairement l'acoustique et, tout autant, centrée sur l’écoute musicale ne peut ignorer les sentiers aventices et apparemment buissonniers que notre petite science emprunte inlassablement à petits pas.
NOTES :
1. Je réduis ici l’opération à son expression minimale. L’oreille n’est pas simplement en situation de dépendance subalterne par rapport à la culture qui est la sienne, puisqu’elle est également productrice de cette culture.
2. Sous des appellations diverses, bien entendu : ainsi la notion de “pertinence” empruntée à la linguistique ou l’opposition Etic/Emic [différenciant drastiquement les faits culturels et leur réalité objective], très répandue dans toute notre discipline depuis au moins une trentaine d’années. Comme on sait cette problématique a été initiée par Pike il y a soixante-dix ans et, à ma connaissance, n’a jamais donné que très localement à un débat critique sérieux pour ce qui est de son application au champ musical (cf. notamment , de Marcia Herndon, 1993, “Insiders, Outsiders, Knowing our Limits, Limiting our Knowing [Emics and Etics in ethnomusicology]” Ethnomusicology 18 (2) : 219-262.
3. D’une certaine façon, ce goût pour le surlignage traduit bien une forme de vulgarité – vulgarité d’autant plus paradoxale que l’art classique aspire toujours à la “distinction” et prétend même, en toutes circonstances, l’incarner.
5. L’histoire n’est pas nouvelle : cette observation avait déjà été faite à propos de Poulenc et de Stravinski, sous forme de reproche, par le grand musicologue de jazz, André Hodeir : les “rag-times” de ce dernier sont, selon lui, bien classiques et fort peu “jazzy” (Hodeir : Hommes et problèmes du jazz, Parenthèses/Epistrophy, 1981 [1ère édit. 1954] : 223-239).
6. On doit à un musicologue suisse, Z . Estreicher , un article déjà ancien ayant pour titre “Le sous-entendu, facteur de la forme musicale”; Schweizer beiträge zur Musikwissenschaft, Publication de la Société suisse de musicologie, Vergag Paul Haupt, série III, 133-156.