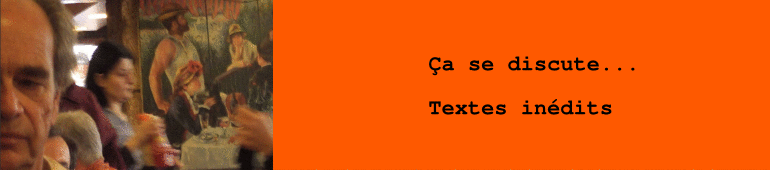Cela revient à reconnaître à la musique une propriété singulière, sinon spécifique, et autorise à centrer notre musicologie sur un fait qui est loin d'être anodin :
sitôt qu’ils deviennent musicaux, les sons, qui relèvent de lois physiques et acoustiques naturelles, semblent changer de qualité; Ils se dotent d’un pouvoir sur les affects. De là à affirmer qu’ils sont là pour cela, il n’y a qu’un pas, et c’est ce pas que je veux franchir : ce qui constituerait le propre du musical tiendrait moins à la nature de l’organisation des sons qu’au fait que ces derniers, dans des conditions particulières, acquièrent une dimension affective.
Mais de leur côté, les affects, aussi sollicités soient-ils, sont tout sauf inertes dans leurs rapports à la musique. En tant que systèmes de pensée et d’action, ils n’ont de cesse de particulariser le champ sonore et de lui attribuer des propriétés sémantico-affectives dont on trouverait difficilement la trace précise dans le son lui-même. Les relations entre les stimuli sonores – qui ne sont jamais de simples stimuli – et l’entendement de ceux qui les produisent ou les reçoivent, sont dans des rapports d'interaction qui n'ont rien d'automatique. Au point qu’il est difficile de savoir qui dirige qui, et qui oriente quoi au cours d’une performance musicale, aussi standardisée soit-elle. La cognition musicale se caractériserait alors par une étrange capacité qui consiste à ne pas faire une distinction claire entre la réalité et l'idée qui lui donne forme et vie.
C’est l’ensemble de ce processus que nous appelons « musique » : soit, un ensemble de sons organisés, bien sûr, mais qui sont musicaux dans la mesure où ils vous touchent. Disons même qu’ils sont d’autant plus musicaux qu’ils vous touchent
.Une telle approche n’est pas sans incidences théoriques. Elle invite à voir la musique autrement qu’un système clos, auto-référencé et dont les propriétés seraient, à ce titre-même, objectivables ; moins comme une fin en soi que comme un device (d’autres diraient « agency ») au service de conduites émotionnelles avec lesquelles elle entretient des relations d’étroite contiguïté.
La conséquence d’un tel point de vue est de taille : la musicologie, dès lors invitée à se recentrer sur les processus cognitivo-affectifs3 , devient une science du sujet 4 – d’un sujet qui pense la musique en même temps qu’il la produit ou la perçoit5
.En fait, il ne s’agit pas seulement de reconnaître que toute parole, en tant qu’unité signifiante, est susceptible d’être musicalisée et que tous les mots de la langue sont susceptibles d’être affectés par la vocalité, mais de considérer que la musique investit le sens bien au-dela des simples mots de la langue
.

Notes
1 . Cela revient à dire que les affects ne peuvent s'abstraire des relations sociales et culturelles dans lesquelles ils s’inscrivent. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils en dérivent et on peut au contraire penser qu'ils sont là pour les rendre possibles. Dans cette perspective, l’"autre social" ne peut être vu comme une abstraction et encore moins prendre la forme d'une règle durkheimienne; il est fait de chair et de sang, pourrait-on dire et implique le sujet dans un système de co-identification de l'autre et de soi [cf. la thèse en cours de Filippo Bonini Baraldi traitant de l'empathie]. Concrètement, cela revient à considérer que si on accorde à l’autre la possibilité d’éprouver joie ou souffrance, c'est parce qu’on a soi-même éprouvé joies et souffrances, soit en synchronie avec lui, soit dans une expérience précdente. Si cela est vrai, la culture des affects devrait être le meilleur des remparts contre la Barbarie.
3 . Pour cette étroite relation entre cognition et affect, voir Damasio : L'erreur de Descartes [1994] (Edition française Odile Jacob 2001).
4 .Ce qui ne veut pas dire qu’elle ait nécessairement à se perdre dans les dédales obscurs et sans grande issue scientifique des subjectivités. Pour cette précision, cf. B. Lortat-Jacob, « Les chemins escarpés des sciences musicales » publié en 2009 et sous une forme un peu différente, en italien : « L’etnomusicologia: una scienza che include il soggetto nell’ oggetto ». Il n’en reste pas moins qu’un affect ne pouvant être affect que dans la mesure où il vous touche, une musicologie fondée sur les affects ne peut être que du sujet.
5 . On notera que cette position se démarque très nettement du schéma tripartite de Molino-Nattiez, qui propose une opposition drastique entre producteurs (ou production) et récepteurs (ou réception).
°°°°°°°
"En savoir plus"
Commentaires critiques de ce texte :
COMMENTAIRES :
KATI BASSET, spécialiste de la musique balinaise et du gamelan, réagit à ce texte – voici une partie de ses commentaires, sélectionnée par moi :
Une autre conception de la musique :
1) Kati B. remet fondamentalement en cause la dimension affective de la musique. Je cite :
« – d’une part, la musique de gamelan, dans sa fonction première rituelle, n’est ni écoutée, ni entendue comme autonome ; elle ne fait pas appel à une conscience de son existence.
– d’autre part, elle semble refuser de toucher les affects, ou en tout cas refuse de susciter des sentiments et détache des affects individuels; elle tend à homogénéiser un affect dépersonnalisé et désincarné, un affect physico-socio-cosmique, comme le fait une musique d’ameublement ou un code signalétique »
[…]
cette musique « meuble » un microcosme sciemment construit par le rituel, où figurent bien d’autres meubles/composantes (= offrandes) sonores, olfactives, visuelles. Ce qui touche éventuellement les affects c’est le tout, car il n’y a aucun focus d’attention; ce n’est même pas vraiment possible d’avoir un focus de perception sur une danse ou une musique : c’est le tout qui est perçu, c’est le tout qui est visé et c’est le tout qui est "ramé", profus, alias "ramya" : beau.
[...] Par son agencement arithmétique de sons, la musique ne fait pas appel à des sentiments, et homogénise dans le public une perception plutôt signalétique. Mais cela dans un cadre (pas si particulier car c’est pareil dans la rue ou dans une kermesse) où la perception du tout rituel, elle, n’est pas homogène, bien au contraire. A l’opposé de l’écoute à la messe ou en salle de concert, où l’on s’efforce d’offrir une perception homogène et simultanée à toute l’audience, on entend quelque chose de différent selon l’emplacement où l’on se trouve. Or, chaque personne a l’occasion ou le devoir (tous les gens sont plus ou moins acteurs; il n’y a pas de public) de se déplacer dans l’espace du rituel. Chaque personne, sauf les initiés : grand-prêtre, dalang, porteurs de masques. »
[…]
« [Il n’en reste pas moins que] le mandala musical – cf. le gamelan mécanique sur le site de la cité de la musique – est auto-référencé et a des propriétés objectivables. On pourrait même supposer que même inconsciemment perçu, c’est le mandala qui est efficace; c’est lui qui élève la perception en la détachant des affects individuels ».
2) Les conceptions balinaises ne doivent rien à Jean-Jacques Rousseau :
« Rien ou quasiment rien de la musique de gamelan ne pourrait répondre aux conceptions d’un Jean-Jacques Rousseau. Et d’ailleurs, pour aborder l’étude du gamelan, il faut oublier notre « musique comme langage » pour la voir comme architecture. Et je sais que cela vaut aussi pour certaines des musiques sacrées occidentales conçues comme cathédrales sonores. Ou pour être plus juste, si on la considère comme langage, il faut oublier le langage profane, la phraséologie quotidienne, et l’envisager avec son « double » qui lui permet de régner secrètement également en architecture, médecine, magie et autres domaines : aksara, mantra- graines et tous les agencements orientés, cardinaux (spatio-temporels non linéaires) de ce niveau sacré du langage ou langage divin (en tant que les dieux hindous sont des principes naturels).
Même les faits d’intonations sont en relation avec l’architecture du corps virtuel de l’initié — elle même copiant l’architecture cosmique —, car sciemment elles consistent à faire vibrer tel ou tel emplacement du système vocal où se trouve inscrit tel ou tel askara et tel ou tel valet du théâtre. En effet, la technique vocale des dalang [montreur de marionnettes] est acquise sur la base des voix des 4 valets (Tualen, Merdah, Delem, Sanggut) inscrits dans son corps, en prononçant les noms de quatre épices (gamongan, kunyt, jahe, et j’ai oublié le 4e) y correspondant : les sons de ces quatre mots sont ceux des voix respectives des quatre valets) […]. [En résumé, pour comprendre la musique de Bali], on ne peut se passer d’une étude stucturale. » cf. lien ci-dessous
<www.cite-musique.fr/gamelan/text_a26.html>
--
Katell MORAND (Thèse en cours sur la musique d'Ethiopie).
Affects et contexte
Il me semble que poser une interaction entre musique/affect/social, avec une place centrale – et surtout gouvernante (au lieu d’être ornementale) – pour les affects, est effectivement une hypothèse très forte. Cela n’a rien à voir avec la musique mais j’ai été très marquée par les livres de Franz de Waal sur les grands singes, en particulier sur les conflits et la réconciliation, et sur la morale, où on les voit à la fois émotionnels et calculateurs (tout un chapitre sur l’empathie, qu’il appelle plutôt « sympathie », dans le bon singe). Il est donc probable, comme il est dit dans la note 1 du texte de B.L.-J, que les affects soient au fondement des relations sociales.
Pour en revenir à la musique, je trouve que cette histoire d’affect pourrait nous amener à redéfinir ce qu’on entend par contexte. On fait souvent comme si la musique se surajoutait à une situation déjà présente, stable, et qu’il suffisait de la décrire pour comprendre les pourquoi sociaux d’une performance, pour « remettre la musique dans son contexte », comme nous disons. Mes idées sur la question sont confuses, mais j’ai l’impression que le « contexte » de la performance non seulement ne préexiste pas à la musique, mais qu’il est créé par les émotions que suscitent la production musicale et son écoute. Deux petites histoires peuvent illustrer cela :
- A mon dernier séjour [chez les bergers amhara, en Ethiopie] Fasigaw sort de prison. Dans ces circonstances, une grande fête devait être organisée par la famille. Or Fasigaw (dont l’épouse est mon hôtesse) a tué son grand frère Malaqu ainsi que son fils. Il a béneficié d’un acquittement après une réconciliation avec l’épouse, le fils aîné, et les filles du défunt – réconciliation qui a privé l’accusation de témoins. Il revient donc à la maison après cinq années d’absence, dont deux de cavale dans la forêt. Sa femme a gardé d’excellente relations avec les autres frères et avec la famille nucléaire du frère assassiné. Il est hors de question de faire la fête, par respect pour elle, et puis parce que le crime continue de passionner le voisinage et est vécu comme un drame originel dans la famille (cela occupe pratiquement toute l’inspiration musicale et des souvenirs de ceux qui sont bergers). Tous les gens des alentours convergent cependant vers notre maison ; et rien ne manque à ce qui devrait être une fête, invités, nourriture, alcool. Rien, sauf la musique, tacitement interdite. Pourquoi ? Parce que ce serait une provocation, m’a t-on répondu, on ne peut pas être heureux. Et sans musique, pas de joie. L’assemblée s’est donc cantonnée à une sorte de platitude émotionnelle convenable (beaucoup d’ennui, en fin de compte) pour un événement qui faisait problème (impossible à la fois de refuser d’accueillir des invités et de célébrer l’événement).
Ce n’est donc pas la joie des gens, due au retour d’un frère, oncle, cousin aimé qui les ferait chanter – donc un contexte – , mais la musique qui aurait créé la joie, le bonheur, et donc l’amour (ou du moins, une situation qui, dans le cas présent, remettrait sur le tapis des relations douloureuses et un statu quo difficilement assumable (comment la mère pourrait-elle pardonner le meurtre et se réjouir, affirmer l’amour pour l’un de ses fils sans renier l’autre ?). Sans musique, c’est donc un non-événement, un non-contexte. C’est dans l’intimité, les jours suivants, que j’ai pu constatr une joie intense chez les bergers (souvenirs heureux de l’époque antérieure au drame, que je n’avais jamais entendus auparavant, et dont on m’a dit qu’ils étaient (ré)suscités par la situation).
- Trois semaines plus tard eut lieu l’anniversaire de la mort du frère Malaqu. Et là, pareil : on ne chanta pas les chants de funérailles pourtant indispensables en cette occasion), car on ne pouvait pas être triste : il ne fallait pas que la famille (surtout les enfants du mort) pleure, car cela raviverait la colère et le ressentiment. Il y aurait donc la cérémonie habituelle (prêtres, banquet, etc.) mais pas de musique, ce qui vidait l’événement de sa substance : la tristesse et, dans le cas d’un meurtre non vengé, (car ces cérémonies sont aussi des rappels à leurs devoirs pour les hommes de la famille), le sentiment de colère et l’envie d’en découdre. Un des frères, celui-là même qui avait œuvré à la réconciliation, m’a assuré qu’il veillerait à ce que personne ne chante. Les jours suivant la cérémonie, les bergers chantèrent beaucoup de chants de funérailles dans leurs pâturages…